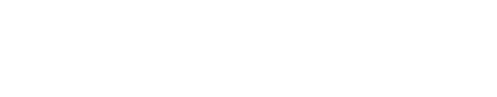Ces derniers jours, l’équipe de recherche dirigée par la professeure WU Xiaojun au Centre international d’innovation en térahertz de l’Institut international d’innovation de l’Université Beihang, en s’appuyant sur un laser femtoseconde industriel chinois à 1 030 nm produit par Hangzhou Aochuang Photonics Technology Co., Ltd, a pompé un cristal de niobate de lithium grâce à la technique du front d’onde incliné. L’équipe a ainsi réalisé une percée dans le développement d’une « nouvelle génération de sources térahertz à trois caractéristiques majeures » : haute puissance moyenne, haute fréquence de répétition et forte brillance, à faible coût.

Grâce à l’emploi du laser industriel chinois dopé à l’ytterbium pour pomper le cristal de niobate de lithium, l’équipe a surmonté le problème de la faible puissance moyenne et de la faible fréquence de répétition des sources térahertz classiques. Elle a mis au point une source térahertz à fort champ dotée d’une puissance moyenne supérieure à 64,5 mW, qui ouvre la voie à des applications croisées dans des domaines tels que l’aéronautique et le spatial, le contrôle non destructif, les circuits intégrés, l’information quantique et le biomédical. Les résultats ont été publiés dans Photonics Research sous le titre « Room-temperature high-average-power strong-field terahertz source based on an industrial high-repetition-rate femtosecond laser », avec l’Institut international d’innovation de l’Université Beihang comme première unité de réalisation.

Cliquez ici pour lire l’article :http://doi.org/10.1364/PRJ.563949
Contexte de la recherche
Les impulsions électromagnétiques térahertz à fort champ en espace libre présentent de multiples atouts : champ électrique de crête élevé (>100 kV/cm), champ magnétique impulsionnel de l’ordre du sub-tesla, durée d’impulsion ultracourte (<1 ps) et bande de fréquences spécifique (0,1–10 THz). Elles permettent de contrôler les trajectoires électroniques, d’exciter les résonances de magnons, de modifier les couplages de phonons et de manipuler le spin. Elles ont déjà prouvé leur valeur dans la recherche fondamentale et recèlent un potentiel industriel immense. Mais le développement du térahertz à fort champ est limité par l’absence de sources efficaces, stables et de haute qualité de faisceau.
De nombreuses méthodes existent pour produire un rayonnement térahertz, mais atteindre une intensité élevée reste difficile. L’interaction entre laser femtoseconde et matière est l’une des voies les plus prometteuses, incluant l’utilisation de cristaux non linéaires, de plasmas gazeux ou d’émetteurs spintroniques à base de nanofilms magnétiques. Parmi elles, l’utilisation d’amplificateurs laser femtoseconde à saphir de titane pour pomper le niobate de lithium s’est imposée, grâce à son fort coefficient de non-linéarité, son efficacité et sa stabilité. Sur ce terrain, l’équipe de la professeure WU Xiaojun et ses partenaires ont successivement établi les premières sources térahertz au niobate de lithium à l’échelle du millijoule puis de la dizaine de millijoules, portant à deux ordres de grandeur le record international resté longtemps à 0,4 mJ (Laser Photonics Rev. 2021 ; Advanced Materials 2023). Ils ont publié plus de 80 articles de haut niveau, souvent qualifiés de « records mondiaux » ou de « jalons scientifiques » par leurs pairs.
Pour aller plus loin, les applications comme la photoémission résolue en angle couplée au térahertz (THz-ARPES), la microscopie optique en champ proche à balayage (THz-SNOM) ou encore la microscopie à effet tunnel couplée au térahertz (THz-STM), exigent des sources térahertz capables de combiner haute puissance moyenne, haute fréquence de répétition, forte brillance et faible coût. Une telle source peut délivrer des intensités de signal de crête supérieures de trois à six ordres de grandeur à celles des spectromètres térahertz à champ faible, rendant possibles des applications de pointe : imagerie rapide et haute qualité, tomographie térahertz (THz-CT), et de nouveaux usages industriels jusqu’ici limités par le flux de photons.
Une voie efficace vers les objectifs mentionnés repose sur les lasers femtosecondes industriels dopés à l’ytterbium, récemment développés, combinant haute puissance moyenne et faible coût, qui sont utilisés pour pomper le cristal de niobate de lithium et générer des sources térahertz à fort champ dotées d’une puissance moyenne élevée. Mais il ne faut pas oublier que ces lasers présentent un dilemme : à haute fréquence de répétition (>10 kHz, voire >100 kHz), l’énergie d’impulsion unique ne dépasse guère 5 mJ. Une autre contrainte est que la largeur d’impulsion reste trop longue dès lors qu’on veut garder une énergie d’impulsion unique élevée. Le maintien de l’équilibre entre ces facteurs pose un défi : l’utilisation de tels lasers femtosecondes à haute puissance pour pomper le cristal de niobate de lithium et générer efficacement du rayonnement térahertz nécessite non seulement de résoudre le problème d’accord de phases, mais aussi de surmonter la faible efficacité due aux impulsions trop longues et les dommages au cristal causés par une puissance de pompage excessive.
Innovations
Dans ces travaux, l’équipe de la professeure WU a utilisé un laser femtoseconde industriel chinois à haute puissance, impulsions longues et faible coût pour pomper le niobate de lithium. Deux schémas de front d’onde incliné – réseau en transmission et miroir à échelons réfléchissant – ont été comparés. Résultat : la configuration à réseau en transmission s’est révélée mieux adaptée au pompage par laser à impulsions longues et à haute puissance. L’équipe a mis en évidence le mécanisme de saturation de l’efficacité térahertz et proposé un nouveau procédé de linéarisation de l’efficacité par compensation synergique. Cette approche a permis d’obtenir une puissance moyenne record de 64,5 mW, posant une base solide pour de futures applications.

Figure 1 : Schéma d’une installation de génération et de détection d’une source térahertz à fort champ et à haute puissance. (a) Technique du front d’onde incliné par réseau en transmission ; (b) Technique du front d’onde incliné par miroir à échelons ; (c) Comparaison des puissances de sortie des sources térahertz de haute puissance développées pendant ces dernières années.
La Figure 1 montre l’installation utilisée pour produire et détecter une source térahertz de haute puissance. Dans la conception optique, les deux schémas de front d’onde incliné — réseau en transmission et miroir à échelons réfléchissant — ont été conçus comme deux modules distincts afin de faciliter la comparaison. Les paramètres du laser de pompage sont les suivants : longueur d’onde centrale de 1 030 nm, largeur d’impulsion inférieure à 600 fs, énergie d’impulsion unique d’environ 1 mJ et fréquence de répétition de 50 kHz. 95 % de l’énergie laser est utilisée pour pomper le cristal de niobate de lithium afin de générer du rayonnement térahertz. L’énergie restante est convertie par un amplificateur paramétrique optique (OPA) en un faisceau de détection nécessaire pour l’échantillonnage électro-optique (50 fs, 600 nJ). Le rayonnement térahertz généré est collecté par un miroir parabolique hors axe. Il est ensuite combiné avec le faisceau de détection grâce à un verre ITO, permettant ainsi de réaliser l’échantillonnage électro-optique afin de s’informer sur la forme d’onde térahertz dans le domaine temporel et la largeur spectrale. Toutes les expériences ont été réalisées à température ambiante du cristal.

Figure 2 : Génération de térahertz par réseau en transmission. (a) Schéma des paramètres et de la configuration du réseau en transmission ; (b) Relation de dépendance de l’énergie d’impulsion unique térahertz et de l’efficacité de conversion vis-à-vis de l’énergie d’impulsion unique du pompage. Les figures montrent respectivement la tache focale térahertz et la tache laser. (c) Forme d’onde térahertz typique dans le domaine temporel et (d) Spectre correspondant.
Les résultats de l’expérience de génération de térahertz via la technique du front d’onde incliné avec réseau en transmission sont illustrés dans la Figure 2. La densité de gravure du réseau en transmission est de 1 000 lignes/mm. Le laser de pompage est dirigé vers le réseau à l’angle d’incidence de Littrow (31°) par deux miroirs réfléchissants, puis la lumière diffractée de l’ordre -1 est réfléchie par deux miroirs réfléchissants vers le système d’imagerie. L’efficacité de diffraction du réseau est supérieure à 95 %. Afin d’éliminer l’impact de la puissance du laser sur la sortie térahertz, la caractérisation des impulsions térahertz a été réalisée à une fréquence de répétition de 1 kHz. Comme le montre la Figure 2(b), une énergie d’impulsion unique térahertz de 1,6 μJ a été obtenue pour une énergie d’impulsion de pompage de 0,85 mJ, ce qui correspond à un rendement de conversion de 0,2 %. La Figure 2(c) présente le signal de forme d’onde térahertz typique dans le domaine temporel mesuré dans l’environnement atmosphérique, tandis que la Figure 2(d) montre la distribution spectrale correspondante, avec une gamme de fréquences de 0,1 à 2,5 THz. La Figure 1(b) montre le spot focal térahertz. La forme d’onde térahertz dans le domaine temporel et l’énergie d’impulsion unique prises en compte, le calcul a donné une intensité de champ de crête térahertz focalisée d’environ 466 kV/cm.

Figure 3 : Caractérisation de la sortie térahertz du miroir à échelons réfléchissant. (a) Relation entre l’énergie d’impulsion unique térahertz et l’efficacité de conversion en fonction de l’énergie de pompage. (b) Spot laser sur la surface d’incidence du cristal. (c) Spot laser au contraste maximal.
Pour savoir si la technique du front d’onde incliné avec miroir à échelons est mieux adaptée à la génération de térahertz avec ce type de lasers de pompage à haute puissance et à longues impulsions, une étude comparative a été menée en utilisant le miroir à échelons réfléchissant. Dans cette expérience, la largeur de chaque échelon du miroir est de 150 μm, et la hauteur de chaque échelon est de 54,6 μm. La conception traditionnelle du pompage à front d’onde incliné par miroir à échelons utilise principalement l’incidence oblique, tandis qu’ici, l’idée d’un isolateur optique a été introduite, permettant au laser d’incider normalement sur le miroir à échelons et évitant ainsi la distorsion du spot de pompage causée par l’incidence oblique. Dans le cas de l’utilisation du miroir à échelons, sa faible réflectivité a limité l’énergie de pompage à 0,7 mJ. L’énergie d’impulsion unique térahertz maximale obtenue était de 1,1 μJ, soit un rendement de conversion de 0,16 % et un champ électrique d’impulsion de crête de 422 kV/cm, résultat inférieur à ce que nous avons obtenu avec le système de réseau en transmission.

Figure 4 : Caractérisation des performances de sortie térahertz à haute puissance de pompage. (a) Comparaison des formes d’onde térahertz dans le domaine temporel à des fréquences de répétition de 1 kHz et 50 kHz ; (b) Spectre correspondant ; (c) Spot focal térahertz et spot focal laser ; (e) Courbe de puissance térahertz ; (f) Courbe d’efficacité térahertz.
Afin d’atteindre une puissance térahertz moyenne élevée sans endommager le cristal, on a élargi le faisceau du laser de pompage et optimisé le système de réseau en transmission. Cela a permis d’obtenir une puissance moyenne de 64,5 mW au point focal du miroir parabolique collecteur (voir Fig. 4(e)). À une fréquence de répétition de 50 kHz, l’efficacité a diminué à l’énergie de pompage maximale, mais l’énergie térahertz a continué de croître, ce qui signifie qu’un pompage avec une énergie d’impulsion unique plus élevée pourrait potentiellement produire une sortie encore plus grande. Pour montrer à quoi sert le térahertz à fort champ, on a détecté la composante du champ magnétique de l’impulsion électromagnétique térahertz en utilisant le moment magnétique Zeeman de CoFe. Cela a résolu le problème de distorsion de la forme d’onde térahertz dans le domaine temporel causé par l’effet de surrotation lors du passage à travers le cristal de ZnTe pour la détection, ce qui a jeté les bases des futures applications en spectroscopie térahertz dans le domaine temporel et en imagerie.

Figure 5 : Démonstration expérimentale d’une application du térahertz à fort champ. (a) Schéma illustrant l’utilisation du moment magnétique de Zeeman pour détecter la composante magnétique du fort champ térahertz. (b) Signal de détection de la composante de champ magnétique. (c) Comparaison de la composante de champ magnétique avec la composante de champ électrique.
Plongés au cœur de l’univers du térahertz, nous brisons les barrières technologiques, relevons les défis par notre travail acharné. L’innovation ouvre de nouvelles voies et les chercheurs de Beihang continueront d’explorer les domaines de recherche de pointe et d’écrire un nouveau chapitre scientifique !
Révision : DONG Zhuoning, ZHANG Wei, XU Shiwen
Édition : YUAN Xiaohui